AVERTISSEMENT : SI LES SYMPTÔMES S'AGGRAVENT, PERSISTENT OU SEMBLENT SÉRIEUX, SVP CONSULTER VOTRE MÉDECIN.

Arbre à thé NPN 80095322
Melaleuca alternifolia
Les multiples vertus curatives de l’huile distillée à partir des brindilles et des feuilles pointues de cet arbre Australien font l’objet d’importantes recherches médicales. C’est un remède traditionnel utilisé par les aborigènes d’Australie pour soigner les blessures infectées.
Histoire : L’arbre à thé fut découvert en Australie par les naturalistes accompagnant le Capitaine Cook dans son deuxième voyage sur l’Endeavour (1772-1775). Ses feuilles remplacèrent le thé dont aurait cruellement manqué l’équipage du grand navigateur. Une autre version veut qu’un lac australien ait guéri les malades s’y baignant parce qu’il était entouré d’arbres bienfaisants dont les feuilles tombaient dans son eau et infusaient au grand soleil. Les vertus cicatrisantes exploitées par les aborigènes étaient si manifestes que les soldats du corps expéditionnaire australien de la Seconde Guerre mondiale ajoutèrent l’arbre à thé à leur pharmacie de campagne.
Quelques idées recettes :
Boutons :
1 goutte d’huile essentielle de
Eucalyptus radié NPN 80095317
Eucalyptus radiata
Son écorce a la particularité de se détacher spontanément du tronc en longs rubans, et ses étroites et longues feuilles vertes étaient utilisées à l'état frais par les Aborigènes d'Australie pour panser les plaies et éloigner les moustiques. Légèrement plus douce que l'huile essentielle d'Eucalyptus globulus, elle en est d’autant plus accessible, notamment pour les enfants qui pourront profiter de ses effets respiratoires expectorants et décongestionnants des plus remarquables. En diffusion, elle agit favorablement sur les individus fatigués, en proie à des fixations ou à une agitation intérieure.
Histoire : L’eucalyptus est un arbre pouvant atteindre 50 mètres de hauteur. Il est certes originaire de Tasmanie en Australie, mais son usage thérapeutique ne connaît pas de frontière. Très prisé en Europe, son usage est aussi répandu aux États unis, en Asie et aux confins de l’Afrique. Dans les hôpitaux allemands, l’Eucalyptus est appliqué sur le corps via des compresses imbibées. Au sein des tribus Zoulous, les guérisseurs utilisent par exemple l’Eucalyptus pour traiter les toux et l’asthme. En Asie, où l’usage traditionnel des plantes médicinales est encore très présent, l’eucalyptus représente un médicament très accessible aussi bien en termes d’approvisionnement que de prix.
Quelques idées recettes :
Respiration :
En application locale: Au niveau des tempes et des sinus, diluée 20% dans une huile végétale, seule ou en association avec des huiles essentielles mucolytiques et antidouleur, telles que la menthe poivrée, ou le romarin officinal à verbénone.
Prudence : ne pas appliquer dans les yeux,
En inhalation :
5 gouttes dans un bol d’eau fumante, en l’absence de fièvre, durant 1 à 10 minutes, inhaler profondément les vapeurs chaudes en position assise. Fermer les yeux. Ne pas sortir à l’extérieur les 30 minutes qui suivent l’inhalation.
Toux :
Par voie orale : 1 goutte d’huile essentielle d'eucalyptus radié + 1 goutte d’essence de citron dans du miel, à laisser fondre dans la bouche 3 fois par jour.
Assainissement Ambiance fraîcheur :
En diffusion: 8 à 15 gouttes d’un mélange à parts égales d'huiles essentielles d’eucalyptus radié, de menthe verte et d’épinette noire.
Note : Ces propriétés, bienfaits et mode d’utilisation sont donnés à titre d’information; ils ne sauraient en aucun cas constituer ni se substituer à une information médicale que seuls peuvent dispenser les professionnels de la santé. Pour tout usage d’huiles essentielles dans un but thérapeutique, veuillez consulter un médecin.
Méthode d’extraction
Distillation à la vapeur d’eau des feuilles et des brindilles
Composants chimiques
Monoterpènes : pinène, myrcène
Monoterpénols : linalol, bornéol, isoterpinéol, géraniol terpinéol
Monoterpénals : myrténal, citronnellal, géranial, néral
Oxyde terp. : cinéole, unépoxycyclomonoterpène, caryophyllène oxyde
Arôme
Pur, vif et perçant. L’huile dégage une odeur puissante et caractéristique aux eucalyptus (légèrement camphré), avec une note plus douce qui dégage les sinus
Mélanges
Bergamote, citron, genévrier, lavande, lemongrass, mélisse, citronnelle, pin sylvestre, romarin.
Propriétés
Anti-infectieuse, antibactérienne, antivirale.
Anti-inflammatoire
Anticatarrhale, expectorante
Analgésique, antinévralgique, antiphylogistique, antirhumatismale, antiseptique, antispasmodique, balsamique, cicatrisante, dépurative, diurétique, expectorante, fébrifuge, hypoglycémiante, insecticide, parasiticide, prophylactique, rubéfiante, stimulante, vermifuge, vulnéraire
Contre-Indications
Aucune connue aux doses physiologiques.
Extraits du livre « L’Aromathérapie – exactement », P. Franchomme (chercheur aromatologue), R. Jollois, en collaboration avec J. Mars (physicien), D. Pénoel (Docteur en médecine). Edition Roger Jollois. Page 353, Extraits du livre « Eucalyptus radiata Sieb. Ex DC. Ssp. Radiata cineolifera. Eucalyptus officinal (feuilles) Myrtacées ».

Cannelle NPN 80096911
Cinnamomum verum
La cannelle est l’une des plus anciennes épices connues : on y fait référence dans les antiques écrits chinois, sanskrits et égyptiens, de même que dans l’Ancien Testament et la Torah. La cannelle emprunta la route de la soie et des épices depuis l’Asie jusqu’en Mésopotamie, puis vers les grandes villes de la Grèce antique et Rome. Les feuilles du cannelier donnent une huile essentielle épicée et proche du clou de girofle connue pour ses propriétés purifiantes. Son nom vient de « canna », qui signifie roseau en latin, et évoque sa forme arrondie obtenue à partir de l’écorce des branches du cannelier qui en séchant s’enroule sur elle-même.
Histoire : Dès le début du 3ème millénaire avant notre ère, elle est utilisée en Chine pour ses propriétés médicinales. La cannelle est déjà connue dans l'Antiquité sans que l’on sache vraiment d’où elle provienne. Elle était considérée comme étant aussi précieuse que l’or et utilisée pour ses vertus médicinales, en digestif, en fortifiant mais aussi comme épice pour aromatiser le vin. En Égypte on l’emploie dans le processus d’embaumement des corps, mais aussi à la confection de parfums et d’huile sainte. On raconte même que Cléopâtre en usait volontiers pour envoûter ses prétendants.
Quelques idées recettes :
Purification de l'air :
En diffusion atmosphérique avec d'autres huiles plus douces : 10 gouttes d’huile essentielle de cannelle + 10 gouttes d’huile essentielle d’orange douce + 7 gouttes d’huile essentielle de lemongrass.
Apaisement, confort digestif :
En mélange dans votre préparation huileuse. Appliquer localement votre mélange en massage ou frictions sur l'estomac et l'abdomen deux frictions par jour :
30 ml d’huile végétale + 5 gouttes d’huile essentielle de cannelle.
La toux :
Par voie orale : Ajoutez 1 goutte d’huile essentielle de cannelle dans une cuillère à thé de miel et mélangez à votre thé favori (3 fois par jour pour une cure interne).
Verser 3 gouttes de la formule avec une cuillère à café de miel et ajoutez le mélange dans un verre d’eau chaud (pas brûlant).
Préparez à l’avance, dans une petite bouteille ambrée à godi-goutte : 2 ml 1/2
50 gouttes d’huile essentielle de citron
12 gouttes d’huile essentielle de cannelle
12 gouttes d’huile essentielle d’eucalyptus radié
1 goutte d’huile essentielle de clou de girofle
Note : Ces propriétés, bienfaits et mode d’utilisation sont donnés à titre d’information; ils ne sauraient en aucun cas constituer ni se substituer à une information médicale que seuls peuvent dispenser les professionnels de la santé. Pour tout usage d’huiles essentielles dans un but thérapeutique, veuillez consulter un médecin.
Méthode d’extraction
Distillation à la vapeur d’eau des feuilles
Composants chimiques
Alcools arom. : Phényléthylique, cinnamique et benzylique
Ester arom. : Benzoates de benzyle et de phényl éthyle; cinnamate de méthyle
Phénols : Eugénol, isoeugénol, phénol, vinylphénol
Aldhéhydes arom. : cinnamaldéhyde, hydroxycinnamald, benzald, cuminald
Coumarines
Note
De fond
Arôme
Chaud et épicé, Fruité, poivré, vanillé.
Mélanges
Bergamote, citron, orange, ylang-ylang, mandarine, gingembre, vanille, clou de girofle.
Propriétés
Anti-infectieuse, antibactérienne à très large spectre d’action et à action puissante (98% des bact. Patho., coques gr+, bacilles gr-), antivirale, antifongique (candida, aspergillus, y compris ceux producteurs d’aflatoxines), antiparasitaire, antifermentaire et antiseptique+++
Tonique et stimulante générale, sexuelle-aphrodisiaque, emménagogue (renforce les contractions utérines), respiratoire et nerveuse (sympathicotonique)
Hyperémiant
Anesthésiante
Anticoagulante légère, fluidifiante
Contre-Indications
Usage cutané (sauf localisé et diluée dans l’huile végétale) Dermocaustique. Interdit aux enfants de moins de 5 ans.
Extraits du livre « L’Aromathérapie – exactement », P. Franchomme (chercheur aromatologue), R. Jollois, en collaboration avec J. Mars (physicien), D. Pénoel (Docteur en médecine). Edition Roger Jollois. Page 334, Extraits du livre « Cinnamomum verum presl. (Feuilles) Lauracées ».

Lemongrass NPN 80096213
Cymbopogon citratus
Le lemongrass ou verveine des Indes est utilisé dans la médecine indienne traditionnelle pour soigner les maladies infectieuses et faire tomber la fièvre. Son pouvoir insecticide n’est plus à faire. C’est aussi un stimulant digestif et une herbe aromatique. Son odeur délicatement citronnée est très appréciée en diffusion : elle rappelle d’autres espèces comme la citronnelle et le palmarosa.
Histoire : Cette plante aromatique originaire des Indes et de la famille de la citronnelle est une grande herbe vivace. Elle pousse spontanément ou est cultivée dans les régions tropicales, principalement en Amérique centrale. Les Anglais, qui l’apprécient tant, lui ont donné son nom lemongrass. Les indigènes de Malaisie consomment des décoctions de feuilles et racines réputées pour soulager les troubles urinaires et les maux d’estomac. Le lemongrass est également un ingrédient traditionnel des cuisines thaïlandaises et malaisiennes.
Quelques idées recettes :
Apparence cellulite :
2 gouttes dans 8 gouttes d'huile végétale à appliquer sur les zones les plus touchées (cuisses, hanches, fesses) en massant et en laissant bien pénétrer les huiles, pendant 2 à 3 semaines, matin et soir.
Les insomnies, angoisses :
En diffusion, grâce à un diffuseur d’huile essentielle, l’huile peut aider à retrouver le sommeil et l’apaisement grâce à ses propriétés relaxantes et sédatives.
Cheveux (gras ou ternes, pellicules) :
2 gouttes maximum dans le creux de la main mélangées au shampoing.
Digestion difficile, ballonnements :
Diluer 15 gouttes avec une huile végétale (30 ml) et masser le ventre et les pieds.
BIEN-ÊTRE - Bain pétillant pour deux :
Pour 300 grammes de sels de bain, il vous faut :
6 cuillères à soupe de sel de l’Himalaya ou sel d’Epsom
5 cuillères à soupe de lait en poudre
10 cuillères à soupe de bicarbonate de soude
4 cuillères à soupe d’acide citrique
1 cuillère à café d’huile d’olive
6 gouttes d’huile essentielle de gingembre
6 gouttes d’huile essentielle de lemongrass
Mode opératoire : Mélangez le sel de l'Himalaya (ou le sel d'Epsom), le lait en poudre, le bicarbonate de soude et l'acide citrique dans le bocal stérilisé. Dosez l'huile d'olive dans la cuillère à café et ajoutez-y directement les huiles essentielles. Intégrez petit à petit le mélange huile d'olive/ huiles essentielles au mélange sec tout en remuant continuellement avec un mini-fouet afin d'éviter la formation de grumeaux. Voilà, c'est prêt !
Note : Ces propriétés, bienfaits et mode d’utilisation sont donnés à titre d’information; ils ne sauraient en aucun cas constituer ni se substituer à une information médicale que seuls peuvent dispenser les professionnels de la santé. Pour tout usage d’huiles essentielles dans un but thérapeutique, veuillez consulter un médecin.
Méthode d’extraction
Distillation à la vapeur d’eau de l’herbe finement hachée.
Composants chimiques
Alcools monoterpénique: terpinéol, bornéol, géraniol et nérol
Alcools sesquiterpénique : farnésol
Aldéhydes monoterpénique : citrals, néral, géranial, citronellal
Aldéhyde sesquiterpénique : farnésal
Aldéhydes : limonène
Terpènes : myrcène
Note
De tête
Arôme
Citronné, avec des notes riches
Mélanges
Arbre à thé, basilic, bergamote, camomille romaine, cèdre de l’atlas, eucalyptus citronné, genévrier, géranium, gingembre, jasmin, lavande, myrrhe, néroli, niaouli, patchouli, romarin.
Propriétés
Antiseptique et anti-inflammatoire : les huiles contenant des aldéhydes monoterpénique (géranial, néral, citronnellal) et des monoterpénols (géraniol), comme l’huile essentielle de lemongrass, possèdent des propriétés anti-infectieuses surtout antivirales (grippe) et anti-inflammatoires.
Stimulante circulatoire et vasodilatatrice : le lemongrass aide à la dilatation des vaisseaux sanguins et favorise une meilleure circulation du sang dans l’organisme.
Stimulante digestive et hépatique : c’est le citral qui est à l’origine de la stimulation des sphères digestives et hépatiques.
Pour le bien-être, un stimulant nerveux et tonique psychique : le mélange de géranial et de néral contenu dans l’huile a un effet légèrement tonifiant sur le système nerveux central.
Indications
Angoisse et anxiété, asthénie (et fatigue intellectuelle), concentration, confiance en soi, convalescence, créativité, tristesse et pessimisme
Contre-Indications
Aucune connue, mais irritante en usage externe.

















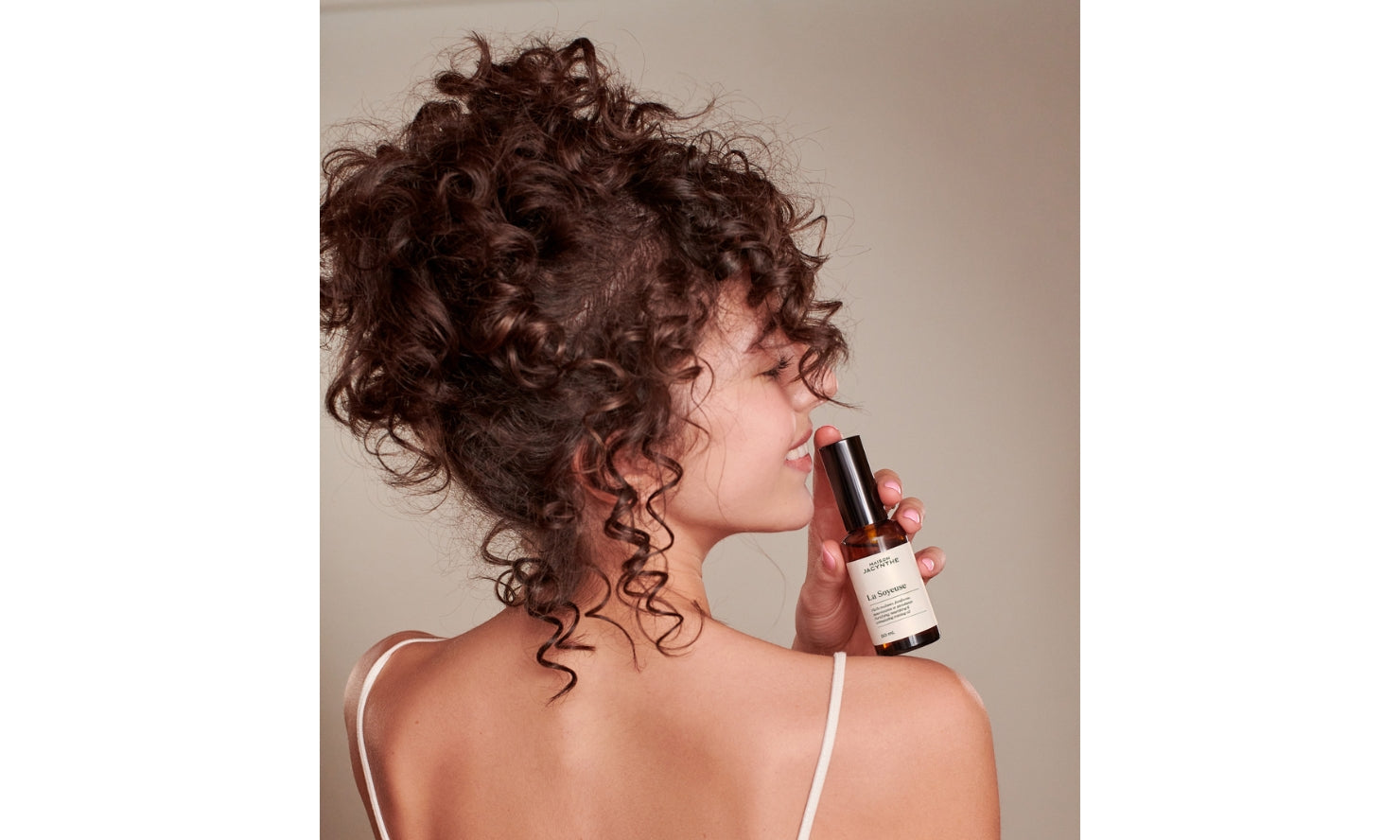



















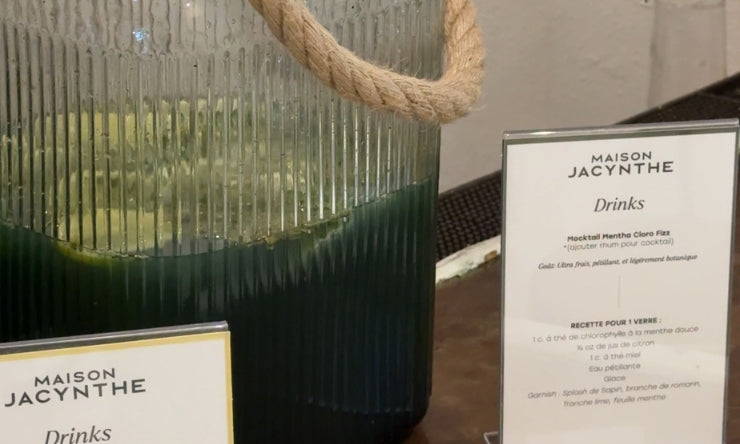







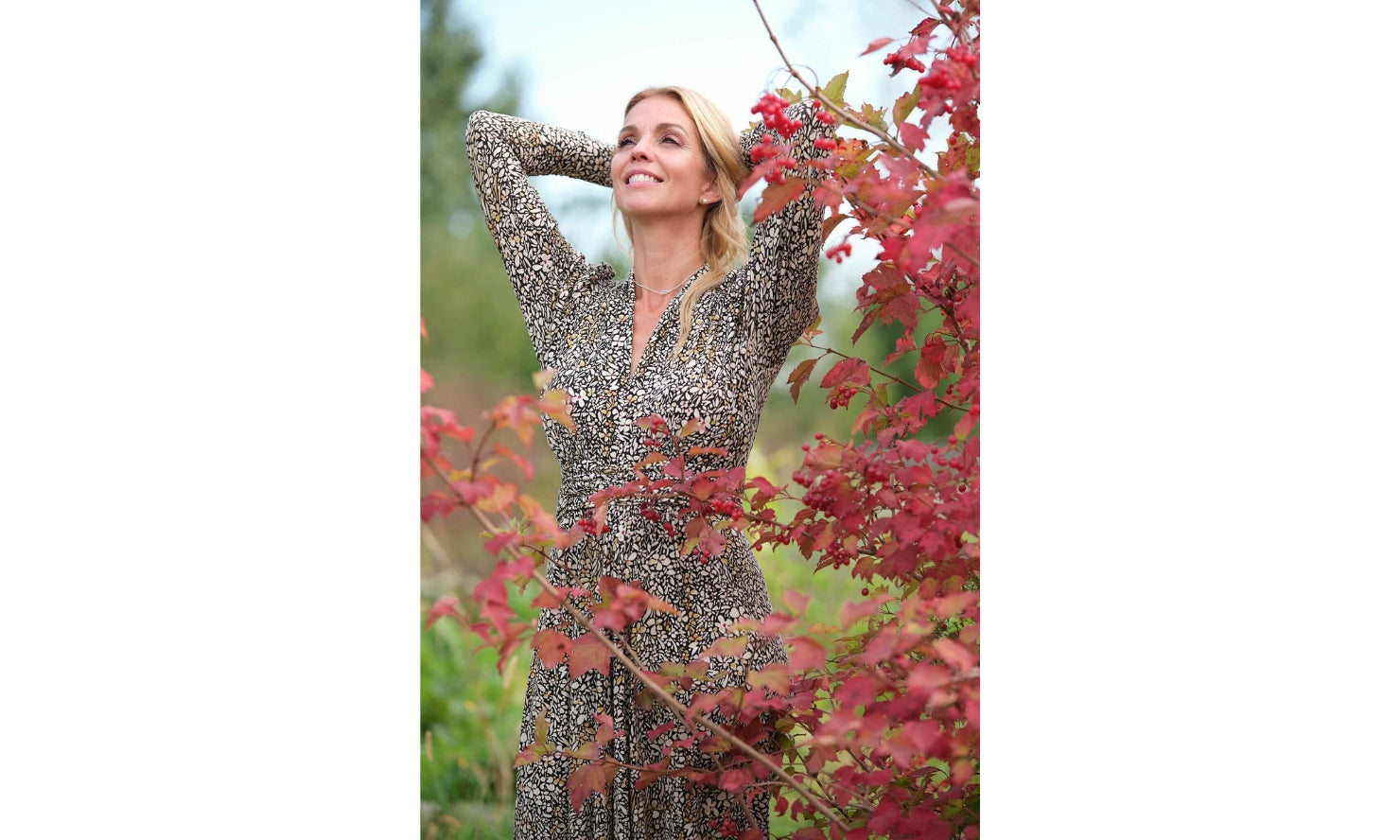


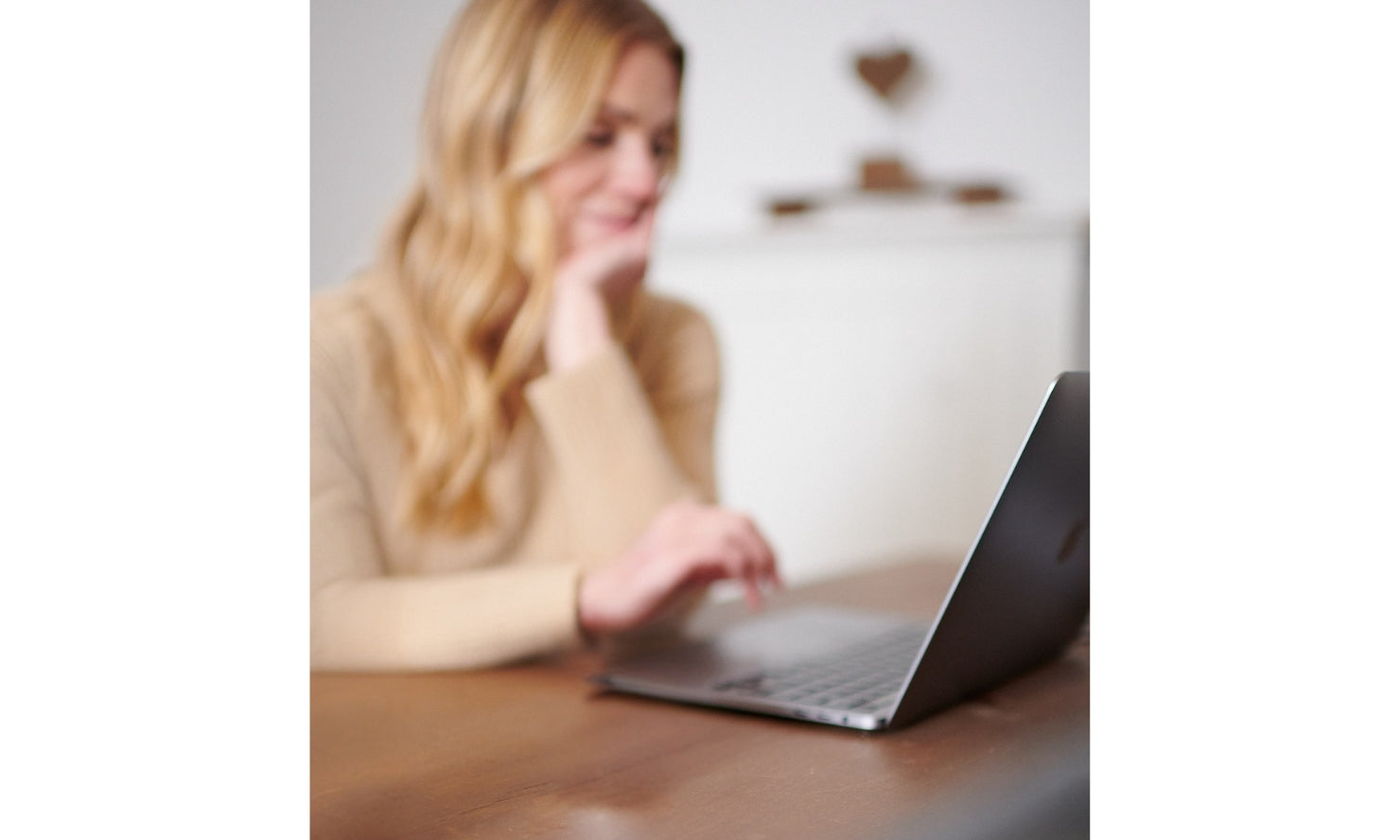

















Laissez un commentaire